La violence conjugale comme un enjeu émergent de santé et sécurité au travail : genèse et réalisations d’un partenariat porteur
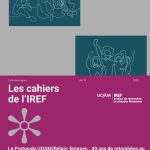
En collaboration avec Isabelle Fortin (CAVAC Côte-Nord), Nadia Morissette (Centre Femmes aux 4 Vents) et Hélène Millier (Maison des femmes de Baie-Comeau).
Responsabiliser l’employeur pour la violence conjugale vécue par une travailleuse oblige à rompre avec l’idée tenace voulant que cette violence soit une affaire privée. Or, le partenariat de recherche, dont il est question dans cet article, a été à l’origine d’une modification de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) faisant en sorte que, depuis le 6 octobre 2021, au Québec, les employeurs doivent prévenir la violence conjugale au travail et le cas échéant, protéger la travailleuse exposée à une situation de violence conjugale sur son lieu de travail ou à proximité (LSST, art 51(16)). Avant d’en arriver là, il a fallu convaincre non seulement le gouvernement, mais aussi une multitude de parties prenantes (associations syndicales et patronales, institutions publiques, etc.) du fondement, de l’opportunité, voire de la nécessité d’inclure une telle disposition au sein du régime de la santé et de la sécurité du travail (SST). Comment nous y sommes-nous prises pour ce faire? Quels sont les facteurs conjoncturels qui ont facilité notre démarche et quels sont ceux qui ont ralenti ou nui à notre démarche? Sans prétendre mettre de l’avant une recette magique, le projet a permis de démontrer le potentiel de la recherche partenariale féministe pour instiguer des réformes législatives susceptibles de contribuer de façon pérenne à la sécurité physique, psychologique et financière des femmes.
Dans cet article, nous proposons d’abord d’exposer la genèse du projet (Section 1). Ensuite, nous identifierons les raisons de son succès ainsi que certains défis qui demeurent à la fin du projet (Section 2). Et puis finalement, nous répertorierons les nombreuses retombées du partenariat, qu’elles soient scientifiques ou sociopolitiques (Section 3). Pour ce faire, nous aurons recours aux axes d’analyse des recherches partenariales féministes dont, en premier lieu, l’importance capitale de la temporalité (Kurtzman et Lampron, 2018), et nous revisiterons quelques facteurs de succès pour de telles recherches, et ce, à partir d’une revue de littérature sélective. Conformément aux préceptes de la recherche féministe, nous nous arrêterons autant à comment le projet s’est déroulé au sein de l’équipe qu’aux actions concrètes que les membres du comité ont entreprises pour arriver à atteindre nos objectifs (Nolet et al., 2017).
Pour mener à bien cet exercice, nous puiserons dans nos souvenirs et impressions en tant que membres de l’équipe, dans les procès-verbaux détaillés pris au cours des 43 rencontres du comité d’encadrement (2019-2022) ainsi que dans les notes prises lors d’une rencontre d’équipe de deux heures visant à faire le bilan du projet en date du 6 octobre 20221Nous avons obtenu la permission explicite des membres de l’équipe pour cet exercice..
Nous verrons que dans un contexte d’étroite interdépendance des savoirs, le respect partagé qui s’est instauré entre les membres de l’équipe à l’aide du rôle médiateur de l’agente de développement du Service aux collectivités de l’UQAM (SAC-UQAM) a été un facteur clé dans le succès du projet. Ainsi, dans le contexte successif de la première réforme du régime de la SST depuis 40 ans (automne 2019), le début de la pandémie de la COVID-19 (mars 2020) et la montée des féminicides au Québec (2021), l’équipe a su déployer une panoplie d’actions pour mobiliser les milieux de travail dans la lutte contre la violence conjugale.
1. Genèse du projet
Le projet La reconnaissance d’une obligation explicite de l’employeur en matière de violence conjugale au Québec (2019-2022) a été initié par des groupes de la Côte-Nord, documentant la problématique de la violence conjugale au niveau régional depuis plusieurs années et réfléchissant de manière concertée aux actions structurantes et systémiques à mettre en place afin de faciliter la prévention de la violence et l’accompagnement des victimes. Plusieurs enjeux préoccupants sont rencontrés lorsque la victime détient un emploi, allant du sabotage de sa performance au travail à sa traque, et même à une agression par le conjoint violent sur son lieu de travail (Cox, 2019; Cox et Ederer, 2021). À la suite de la recommandation de l’R des centres de femmes du Québec d’approcher le SAC-UQAM et après avoir entendu la chercheure universitaire en conférence, les groupes de la Côte-Nord ont souhaité mener le projet via le soutien du Protocole UQAM/Relais-femmes (tout en s’insérant dans le Protocole UQAM/CSN/CSQ/FTQ) avec la collaboration de la professeure et chercheure au Département des sciences juridiques de l’institution.
Au moment où la chercheure universitaire a commencé à jouer un rôle dans le projet, les partenaires avaient déjà défini le besoin des femmes victimes de violence conjugale de bénéficier d’un soutien de la part de leurs employeurs, notamment pour sécuriser leur milieu de travail et ainsi éviter qu’elles aient à choisir entre leur sécurité personnelle et leur emploi. De plus, les partenaires avaient déjà obtenu un financement de la part du ministère de la Justice afin de produire une trousse d’information à l’intention des employeurs, pour les outiller à cette fin. Ainsi, il ne fait pas de doute que la genèse du projet appartient aux partenaires, parmi lesquels une belle synergie existait bien avant le début du partenariat avec les universitaires.
Ensuite, la contribution de la chercheure a été d’identifier le bon point de chute dans le paysage juridique québécois pour rendre l’employeur imputable d’une obligation en matière de violence conjugale, soit le régime de la SST, et ce, à la fois pour des raisons philosophiques (importance de mesures préventives) et pragmatiques (une réforme du régime SST était déjà en cours). Et puis, illustrant la capacité unique des chercheures universitaires à « tirer des conclusions scientifiques à partir de données empiriques » (Nolet et al., 2017 : 277), elle a produit une étude du cadre législatif en vigueur dans les juridictions ailleurs au Canada, permettant de conclure que le Québec accusait un retard en matière de protection de victimes de violence conjugale dans leurs milieux de travail. Par la suite, le message voulant que « le Québec [soit] en retard… » s’est avéré un slogan puissant pour attirer l’attention médiatique sur les revendications de l’équipe, alors que le nombre de féminicides au Québec grimpait de façon ahurissante lors de la pandémie de la COVID-19 (CSF, 2020).
Après avoir été mandatée par l’équipe, la chercheure universitaire a profité d’un lien professionnel lointain avec le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de l’époque, Me Jean Boulet, auparavant avocat patronal, pour interpeller celui-ci. À la satisfaction de toutes, dans les semaines qui ont suivi l’envoi de cette missive, une représentante de son Cabinet a communiqué avec la chercheure pour convenir d’une rencontre avec toutes les partenaires. Fébriles, les partenaires sont parties de la Côte-Nord pour aller à la rencontre des membres de l’équipe de l’UQAM, tout aussi fébriles, dans les bureaux du Cabinet du Ministère dans le centre-ville de Montréal. Et comme on dit, la suite fait maintenant partie de l’histoire!
2. Conditions et facteurs de succès
Du point de vue de la recherche partenariale, le concept d’interdépendance est défini comme « une valorisation mutuelle des ressources des membres de l’équipe » (Nolet et al., 2017 : 271). Choisissant ce cadre conceptuel, Nolet et collègues proposent « d’appréhender l’expertise non pas comme une caractéristique des personnes, mais plutôt comme une construction sociale rendue possible par la rencontre d’acteurs et d’actrices mutuellement intéressés » (Nolet et al., 2017 : 272).
Ainsi conçue, l’expertise de l’équipe s’est manifestée notamment dans sa capacité d’adaptation à une conjoncture changeante. En effet, alors que le dépôt d’un projet de loi incluant possiblement la modification législative souhaitée était initialement prévu au cours de la semaine du 16 mars 2020, le 13 mars 2020, le Québec a été placé en confinement en raison de la pandémie; l’Assemblée nationale a abruptement cessé de siéger. L’équipe s’est rabattue sur la production de capsules vidéo en lien avec la violence conjugale dans un contexte de télétravail. Dans les semaines suivant le communiqué de presse annonçant la diffusion des capsules au mois de mai 2020, le projet a paru dans les médias à près d’une cinquantaine de reprises. Si l’attention médiatique mettait l’accent sur la parole de la chercheure universitaire, ce sont néanmoins les partenaires qui ont généré un contenu essentiel à son discours, la littérature savante (lacunaire au début du projet) n’étant d’aucun secours sur la question jusqu’alors inusitée de la violence conjugale et les milieux de travail en temps de pandémie.
La stratégie médiatique de l’équipe et la part d’improvisation associée ont nécessité un lien de confiance important entre la chercheure et les partenaires. Ici comme à d’autres moments, l’agente de développement a joué un rôle clé d’interprète, servant en quelque sorte de point de bascule entre les partenaires et la chercheure, entre le « langage » du milieu universitaire et le « langage » du milieu communautaire (Bussières, 2018). L’agente s’assurait que chacune était entendue lors des multiples rencontres du comité d’encadrement et que chacune saisissait bien les besoins et les limites des autres. Illustration anodine, mais éloquente néanmoins : quand la chercheure universitaire s’affairait à rédiger des ébauches de lettres ouvertes, une des partenaires s’interrogeait sur la nécessité de multiples notes en bas de page. L’agente a pu prendre le relais pour expliquer comment la crédibilité de celle-ci reposait sur l’inclusion de ses sources, créant plutôt un moment de détente et d’humour autour des différences dans les façons de faire.
En fin de compte, le report du Projet de loi anticipé (le gouvernement étant aux prises avec la crise COVID) a permis une stratégie de diffusion à grande échelle, permettant d’obtenir une adhésion plus importante aux objectifs de l’équipe par les parties prenantes. En deux ans et demi, la chercheure universitaire a livré quatre communications scientifiques ainsi que dix conférences et formations (webinaires ou en présentiel) dans les milieux syndicaux et communautaires sur la question de la violence conjugale et les milieux de travail, la plupart du temps accompagnée par des partenaires de l’équipe de recherche ou par d’autres représentantes des milieux communautaires. En multipliant les plateformes afin de faire connaître les rapports entre la violence conjugale et les milieux de travail, l’équipe a réussi à soutenir une conversation pérenne sur les manières de remédier à la violence conjugale et ainsi préparer une mise en œuvre réelle de la Loi.
À maintes reprises et tout au long du projet, les vastes réseaux de l’ensemble des membres du comité d’encadrement, qu’ils soient auprès de syndicats, d’employeurs, de groupes de femmes ou d’acteur·trice×s de la scène politique québécoise, ont été mobilisés pour promouvoir les revendications de l’équipe. Ce processus collectif a permis d’élargir les réseaux traditionnels associés à chacun de ces milieux et de favoriser une diffusion plus large des revendications, le SAC-UQAM ayant joué un rôle de liant dans cette perspective. Le degré d’identification aux objectifs du projet ainsi que la confiance partagée ont motivé chacune à prendre le risque d’interpeller ses contacts privilégiés pour mettre de l’avant le bien-fondé de la modification législative souhaitée.
Le Projet de loi 59 a finalement été déposé en septembre 2021. La disposition sur la violence conjugale a bel et bien été insérée dans une nouvelle disposition sur la violence en général. L’équipe de recherche a soumis un mémoire à la Commission parlementaire portant sur le Projet de loi 59 et la chercheure universitaire a été invitée à témoigner sur la question de la violence conjugale. Le mémoire de l’équipe a été diffusé auprès d’une multitude de groupes et d’institutions interpellés par les questions de l’opportunité et de la mise en œuvre de cette disposition.
Aujourd’hui, la LSST (2022) se lit comme suit:
51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment :
[…]
16° prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel.
Lors de la production du mémoire destinée à la Commission parlementaire, les membres de l’équipe se sont penchées sur la question des mesures de prévention primaire (c’est-à-dire des mesures à prendre en l’absence de tout signalement de violence conjugale). Les partenaires ont pu aiguiller la chercheure à cet égard. Elle s’est ensuite assurée de rattacher ces mesures aux structures existantes au sein du régime SST. Aujourd’hui, le site de la Commission des normes de l’équité de la santé et sécurité au travail (CNESST, 2022) a repris les propos et revendications de l’équipe, en affirmant que l’employeur doit « informer adéquatement les travailleurs sur les risques liés à la violence, dont la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel (les informer sur les signes à reconnaître, les procédures ou politiques en place, etc.) ». Plus encore, toujours selon la CNESST, l’employeur doit, en amont de tout signalement :
- s’assurer que ses établissements sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du personnel (p. ex., contrôle de l’accès aux lieux de travail, caméras de sécurité, bouton panique, etc.);
- s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et protègent la santé des travailleurs (p. ex., permettre à une victime de violence conjugale un retour au bureau si elle est en télétravail).
Ainsi, l’équipe a réussi à demeurer un pas en avant de l’actualité, maintenant son leadership sur l’opérationnalisation de la nouvelle disposition – une fois l’adoption de celle-ci –acquise.
Lors de la production du mémoire, un moment décisif pour l’équipe est survenu lors d’une discussion sur l’importance de la confidentialité d’un signalement de violence conjugale, versus une possibilité pour l’employeur, dans certaines circonstances, de prendre des actions pour sécuriser le milieu de travail, même sans la permission de la victime. La chercheure trouvait difficile, à la lumière du cadre juridique et de la résistance anticipée de la part des associations patronales, de défendre une position voulant que l’employeur doive garantir à tout prix la confidentialité d’un signalement. Pour leur part, à l’unisson, les partenaires mettaient résolument de l’avant le besoin de favoriser une reprise de pouvoir de la victime sur sa vie. Encore une fois, l’agente de développement du SAC-UQAM a su nommer le fait que ces positions divergentes découlaient de points de vue disciplinaires et sectoriels spécifiques, dépersonnalisant ainsi les enjeux. Après une discussion respectueuse, la position défendue par l’équipe s’est avérée celle de la valeur primordiale de l’autonomie de la victime.
Fait intéressant, dans une étude empirique menée par la chercheure universitaire pour examiner la mise en œuvre des dispositions semblables ailleurs au Canada, les mêmes tensions entre la confidentialité et la sécurité ont fait surface :
Les répondantes qui travaillaient de plus près avec des victimes étaient celles qui insistaient le plus sur la nécessité que cette dernière contrôle l’ensemble du processus de prise en charge de sa situation, tant pour celles provenant du milieu syndical que pour celles travaillant dans des maisons d’hébergement. Celles occupant des postes de direction ou de coordination étaient davantage d’avis que certains compromis doivent être acceptés à cet égard. (Cox, 2023 : 20, à paraître).
Dans cette étude, plusieurs répondantes travaillant de près avec les victimes ont souligné que « la confidentialité, c’est la base, le b.a.-ba de la création d’un environnement de travail qui est plus réceptif à la divulgation… » (Cox, 2023 : 16). De plus, elles ont observé que si les victimes ne signalent jamais leur situation, le milieu de travail ne sera pas sécurisé non plus. En fin de compte, les échanges en comité d’encadrement ainsi que les résultats de recherche ont bien outillé la chercheure pour défendre le point de vue de l’équipe devant différents forums publics. Savoir que ce débat est un point d’achoppement dans la mise en œuvre de la législation ailleurs au Canada a été un indice pour l’équipe de l’importance de signaler et de préserver, dès le départ, la valeur primordiale d’une intervention féministe en faveur des travailleuses victimes.
En 2022, au Québec, l’adhésion à grande échelle des associations syndicales, de plusieurs employeurs ainsi que de la CNESST à la mobilisation des milieux de travail dans la prévention de la violence conjugale ne fait pas de doute, en témoigne notamment le succès de l’initiative Milieux de travail alliés (RMFVVC, 2021). Il reste, toutefois, des défis à relever. Selon les partenaires, l’adoption de politiques en matière de violence conjugale et la demande pour des formations et des outils chez les employeurs de la Côte-Nord, où le projet a pris naissance, laissent toujours à désirer, et ce, en dépit d’une couverture médiatique locale et nationale du rôle des partenaires dans l’adoption de la nouvelle disposition, ainsi qu’un taux de prévalence de la violence conjugale qui demeure particulièrement élevé (Gagnon, 2021). Cette région devrait-elle faire l’objet d’une mise en œuvre proactive de la part de la CNESST? L’ensemble des modifications apportées par le Projet de loi 59 devront faire l’objet d’une évaluation par le ou la ministre d’ici 2026, et la question de disparités régionales dans sa mise en œuvre pourrait très bien en faire partie.
Finalement, à l’époque, au Québec, l’idée d’imputer à l’employeur une responsabilité en matière de violence conjugale était somme toute assez novatrice. En effet, cette revendication a surpris plusieurs personnes, tant du côté patronal que du côté syndical, et même chez les groupes de femmes. Les récits mis de l’avant par les partenaires ainsi que la valeur pédagogique de leur Trousse d’information sur la violence conjugale (2021) ont beaucoup aidé les parties prenantes à imaginer en quoi pouvait consister une démarche concrète en la matière et en quoi l’absence d’une telle démarche contribue à placer dans une situation d’échec les femmes cherchant à se soustraire à une relation violente. En ce sens, la Trousse a généré une crédibilité importante pour l’équipe. Avec les connaissances de la chercheure en matière de SST, et rappelant la définition de l’expertise comme « une construction sociale rendue possible par la rencontre […] d’actrices mutuellement intéressé[e]s » (Nolet et al, 2017 : 272), on peut dire que la rencontre des membres de l’équipe a généré une expertise de pointe en matière de mobilisation des milieux de travail dans la lutte contre la violence conjugale.
Un dernier facteur de succès réside dans l’attention portée à ne pas uniquement penser ou décrire des réalités affectant des femmes victimes provenant de groupes majoritaires. À titre d’exemple, l’équipe a été sensibilisée aux préoccupations des groupes de femmes autochtones au niveau définitionnel, plusieurs groupes de femmes autochtones préférant le terme « violence familiale » à « violence conjugale » pour rappeler les liens avec la violence coloniale dont les effets se font sentir tant d’une génération à l’autre qu’au sein des couples (Flynn et coll., 2013 : 40) (soulignons d’ailleurs que les partenaires de la Côte-Nord sont en étroit contact avec ces dernières). De plus, l’équipe a intégré les perspectives de femmes racisées dans des évènements de diffusion et a précisé, dans plusieurs outils, les marginalités spécifiques affectant certains groupes de femmes. La provenance des partenaires communautaires – Sept-Îles et Baie-Comeau, respectivement – a rendu essentielle la prise en compte constante des réalités rurales et des régions éloignées des métropoles, où la violence conjugale se manifeste de façon particulière (Farhall 2020 : 106), élément qui a résonné pour beaucoup de personnes, entre autres dans les milieux syndicaux. Cette mise de l’avant de la pluralité des femmes affectées par la violence conjugale en milieu de travail a probablement contribué à l’adhésion large des mouvements féministes et syndicaux aux revendications.
3. Retombées du projet
Ces retombées sont nombreuses et de divers ordres. En termes de diffusion, outre les communications scientifiques déjà évoquées, on compte près d’une centaine de mentions du projet dans les médias, auxquels se sont ajoutées les nombreuses présentations, en ligne (deux webinaires, quatre capsules vidéo, un podcast) et présentielles, réalisées auprès d’une diversité d’acteur·trice·s : syndicats, universitaires, intervenantes, notamment.
Une retombée majeure, sur le plan politique, est bien entendu l’adoption de la Loi avec la disposition recommandée par l’équipe, avec les appuis politiques, syndicaux, universitaires et des groupes féministes. Cela dit, d’autres interventions parallèles réalisées en amont de l’adoption (diffusion d’un Avis sur le télétravail, correspondance avec la Coroner responsable du Comité d’examen des décès liés à la violence familiale) ont également permis d’insuffler la vision de l’équipe à des acteur·trice·s clé, le tout dans un contexte pandémique et de féminicides critique.
Or, depuis l’adoption de la loi, d’autres retombées subséquentes des actions de l’équipe sont identifiables. En effet, une collaboration étroite avec la CNESST a permis tant aux groupes qu’à la chercheure universitaire de collaborer dans la production des outils produits aux fins de la mise en œuvre de la nouvelle législation : on pense notamment à la participation de membres de l’équipe à la formation de l’inspectorat dans les milieux de travail, au référencement de la Trousse produite par les partenaires sur le site web et dans les capsules de la CNESST, ainsi qu’aux commentaires transmis sur les mises en situation présentées sur le site web, qui ont été pris en compte par la Commission. C’est donc dire que si le Québec accusait un retard significatif à l’origine du projet (2019), trois ans plus tard, tout porte à croire qu’il sera bientôt en tête de peloton quant à la mise œuvre de cette disposition protectrice des travailleuses victimes de violence conjugale (Cox, 2023).
Le projet a aussi permis d’asseoir le socle de nouvelles collaborations avec des acteur·trice·s (syndicaux·ale·s, gouvernementaux·ale·s) rencontré·e·s dans ce cadre. Au niveau scientifique, il a permis à la chercheure de consolider et de faire reconnaître son expertise sur la réglementation de la violence basée sur le genre dans les milieux de travail et à des étudiantes de cosigner des articles. Il a également permis à une recherche partenariale menée dans le cadre du SAC de rayonner tant à l’intérieur de l’institution (intégration du projet dans une campagne publicitaire de l’UQAM) qu’à l’externe, contribuant ainsi à réaffirmer la pertinence de ce modèle. De manière plus globale, on peut aussi avancer que le projet a permis d’apporter une autre pierre à l’édifice de reconnaissance de la violence conjugale comme problématique sociale et publique d’importance, dont doivent se saisir une pluralité d’acteur·trice·s, incluant les milieux de travail.
Conclusion
Les raisons du succès du projet partenarial incluent la synergie entre les organismes de la Côte-Nord, qui a mené à la genèse du projet, ainsi que le contexte social dans lequel le projet s’est déployé (mobilisations en lien avec les féminicides) et qui l’a traversé (pandémie de la COVID-19). Entre le confinement du Québec en raison de la pandémie et la reprise des travaux à l’Assemblée nationale, la stratégie de diffusion de l’équipe, tant auprès des médias qu’auprès des acteur·trice·s des milieux de travail, a contribué à faire connaître le rôle de ces derniers dans la lutte contre la violence conjugale et à obtenir une large adhésion sociale à la revendication de l’équipe.
Tout au long du projet, les vastes réseaux de l’ensemble des membres du comité d’encadrement ainsi que le fort sentiment d’engagement de toutes ont propulsé les nombreuses actions entreprises, décidées en toute sérénité, avec des rires et parfois avec des larmes, lors des nombreuses rencontres du comité d’encadrement. L’interdépendance des savoirs, ainsi que le respect partagé qui s’est instauré entre les membres de l’équipe, à l’aide du rôle médiateur du SAC-UQAM, ont été des facteurs clés de son succès. Si la conjoncture unique dans laquelle le projet s’est déroulé ne se produit plus, il est à espérer que le soutien institutionnel efficace et structurant du Protocole UQAM/Relais-femmes du SAC-UQAM, permettant des rencontres « d’actrices mutuellement intéressées », un corenforcement des expertises ainsi qu’un contexte propice à la « valorisation mutuelle des ressources des membres de l’équipe » (Nolet et al., 2017 : 271), lui, soit pérenne.
Notes de bas de page
- 1Nous avons obtenu la permission explicite des membres de l’équipe pour cet exercice.
Bibliographie
Bussières, Denis. (2018). La recherche partenariale : d’un espace de recherche à la coconstruction de connaissances. [Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal].
Commission des normes de l’équité de la santé et sécurité au travail (CNESST). (2022, 5 décembre). Violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. CNESST. https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-risques/liste-informations-prevention/violence-conjugale-familiale-caractere-sexuel
Comité Politique de travail en violence conjugale (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Côte-Nord, Centre Femmes aux Quatre Vents et Maison des femmes de Baie-Comeau). (2021, 5 décembre). La violence conjugale : une responsabilité dans mon milieu de travail. Trousse d’accompagnement pour les entreprises, les syndicats et les membres du personnel. http://www.violenceconjugaleautravail.com/
Conseil du statut de la femme. (2020, 20 mai). Les violences conjugales au temps de la COVID-19. Conseil du statut de la femme. https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/societe/les-violences-conjugales-au-temps-de-la-covid-19/
Cox, Rachel. (2023, à paraître). La mise en œuvre des dispositions SST sur la violence conjugale au Canada. [Service aux collectivités] Université du Québec à Montréal.
Cox, Rachel et Ederer, Mélanie. (2021). Le traitement de la violence conjugale comme un enjeu de SST au Canada : une étude empirique. Communitas, 1 (2), 1-34. https://communitas.uqam.ca/wp-content/uploads/2022/03/Cox-et-Ederer-2021-1.pdf
Cox, Rachel, avec la coll. de Fortin, Isabelle, Millier, Hélène, Morissette, Nadia. (2021). Mémoire présenté au sujet des dispositions du Projet de loi 59 sur
l’obligation de protection de l’employeur en matière de violence conjugale. [Présenté à la Commission de l’économie et du travail en janvier 2021]. https://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_170753&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
Cox, Rachel, avec la coll. de Desmarais, Marie-Ève et Roy, Shanie, en partenariat avec le CAVAC Côte-Nord, le Centre Femmes aux 4 Vents, la Maison des femmes de Baie-Comeau et la Maison L’Amie d’Elle. (2019). La reconnaissance d’une obligation explicite de l’employeur en matière de violence conjugale au Québec : rapport de recherche. [Service aux collectivités] Université du Québec à Montréal. https://sac.uqam.ca/upload/files/Violence_conjugale_reconnaissance_explicite_obligation_employeur_Cox_2.pdf
Farhall, Kate. (2020, mai). Towards an Integrated Theoretical Framework for Understanding Women, Work and Violence in Non-Metropolitan Contexts. Journal of Rural Studies, 76, 96-110.
Flynn, Catherine, Lessard, Geneviève, Montminy, Lyse et Brassard, Renée. (2013). Sortir la violence de sa vie, sans sortir de l’autochtonie : l’importance de mieux comprendre les besoins des femmes autochtones en milieux urbains. Alterstice, 3 (2), 37-50.
Gagnon, Katia. (2021, 19 avril). Violence conjugale : le fléau invisible de la Côte-Nord. La Presse. https://www.lapresse.ca/actualites/2021-04-10/violence-conjugale/le-fleau-invisible-de-la-cote-nord.php
Kurtzman, Lyne et Lampron, Eve-Marie. (2018). Coconstruire des connaissances féministes : l’exemple du Service aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal. Nouvelles questions féministes, 37 (2), 14 29.
Loi sur la santé et sécurité au travail, RLRQ c. S-2.1. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.1
Nolet, Anne-Marie, Cousineau, Marie-Marthe, Maheu, Josiane et Gervais, Lise. (2017). L’interdépendance dans la recherche partenariale. Nouvelles pratiques sociales, 29 (1-2), 271 87.
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC). (2021). Milieux de travail alliés contre la violence conjugale au travail. https://milieuxdetravailallies.com/
, 2023, « La violence conjugale comme un enjeu émergent de santé et sécurité au travail : genèse et réalisations d’un partenariat porteur », dans Ève-Marie Lampron, Ama Maria Anney, Mylène Bigaouette, Sophie Gilbert, Julie Raby et Marina Seuve (dir.), Le Protocole UQAM/Relais-femmes : 40 ans de retombées au service des savoirs et de l’action féministes, Cahier de l’IREF no10, en ligne sur PréfiX, https://revues.uqam.ca/prefix/cahiers-iref/la-violence-conjugale-comme-un-enjeu-emergent-de-sante-et-securite-au-travail-genese-et-realisations-dun-partenariat-porteur/
Cahier IREF
Ce travail est sous une licence CC BY-NC-ND 4.0.
