Chevalière en mission : programme en orientation de carrière visant l’autonomisation socioprofessionnelle de femmes victimes de violence conjugale
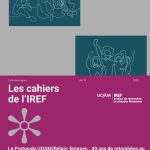
En collaboration avec l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale et Chantal Lepire
Brève présentation du milieu de pratique qu’est L’Alliance des maisons d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
L’Alliance MH2 regroupe 35 maisons membres réparties dans 14 régions du Québec. Les maisons membres offrent actuellement 145 unités d’hébergement. Ces unités, en plus d’être sécuritaires et confidentielles, ont pour principal objectif de prévenir les risques d’homicide conjugal en offrant des services spécialisés pour les victimes de violence conjugale postséparation (VCPS). Les MH2 s’inscrivent dans un continuum de services en violence conjugale, offrant des unités d’hébergement transitoires sous forme de logements aux femmes qui vivent de la VCPS et qui ont besoin de services psychosociaux adaptés. En effet, lorsqu’il est question des volets d’hébergement, on retrouve tout d’abord l’hébergement d’urgence (1re étape) pour les femmes qui quittent un conjoint violent et qui ont besoin de sécurité immédiate. Ce sont des séjours de plus courtes durées, soit en moyenne d’un à trois mois. Les femmes qui y sont hébergées sont souvent en mode survie. Elles vivent énormément d’ambivalence, évaluant un possible retour ou non avec le partenaire violent. Les allers-retours en maisons dites de 1re étape sont fréquents. Pendant leur séjour en maison d’urgence, les femmes explorent différentes solutions pour mettre un terme au cycle de la VC. En 2e étape, elles sont plutôt en période de réorganisation de vie et bonifient leur plan de sécurité en l’adaptant à la VCPS. Selon une étude, 8 % des femmes ayant séjourné en maison de 1re étape auront besoin de la sécurité et des services d’une MH2 (Cousineau et al., 2016 : 5) . L’Alliance MH2 est donc une association provinciale qui assure un lieu de mobilisation et de concertation pour ses membres. Elle veille à la promotion de leurs intérêts en les soutenant dans leur développement ainsi que dans la poursuite de leur mission. Interlocutrice incontournable auprès de différents paliers gouvernementaux, l’Alliance MH2 poursuit une orientation féministe et militante (Alliance MH2, 2022)
Mise en contexte
L’obtention d’un logement en MH2 offre la possibilité aux victimes de VC de bénéficier, en plus d’un logement sécuritaire et confidentiel, d’un cadre de vie dans lequel on retrouve une gamme de services psychosociaux spécialisés en VCPS. Ces services amènent les femmes à reprendre du pouvoir sur leur vie au travers d’un rôle nouveau de femme cheffe de famille, grâce au soutien des intervenantes psychosociales spécialisées en VCPS. Habiter un logement de 2e étape offre donc aux femmes ayant fui un conjoint violent la possibilité d’évoluer à leur rythme et de commencer à formuler des objectifs de vie positifs, dont l’amorce d’une réflexion sur leur avenir professionnel. Dans une perspective de dévictimisation, il importe de souligner que lorsque le projet a été pensé, aucun service spécialisé en développement ou en orientation de carrière n’existait au sein des maisons de 2e étape. L’autonomisation socioprofessionnelle était pourtant identifiée comme un élément crucial dans la reprise de pouvoir des femmes victimes de VC (Privé, 2016). En effet, un conjoint ayant des comportements violents utilise plusieurs moyens afin de contrôler sa victime et de prendre le pouvoir sur cette dernière. La violence économique permet souvent au conjoint d’assurer un contrôle nocif auprès des femmes. Au sein d’une dynamique de VC, cette stratégie permet au conjoint violent de limiter les choix de la victime à plus long terme. Entraînant une mainmise du conjoint sur la gestion de temps et d’argent des femmes, la violence économique entraîne une dépendance qui limite gravement la capacité de la femme à pouvoir subvenir éventuellement à ses besoins (SOS violence conjugale, 2022).
Traore (2014) rapporte plusieurs études démontrant que l’autonomie financière des femmes victimes de VC est un enjeu majeur lorsqu’elles tentent de mettre fin à une relation violente. Il importe pour l’Alliance MH2 d’offrir aux femmes hébergées des services spécialisés afin qu’elles puissent amorcer une démarche de réflexion qui les mène à des actions stratégiques nécessaires à une plus grande autonomie socioprofessionnelle. Bien que l’on puisse reconnaître l’autonomisation socioprofessionnelle comme agent de changement pour les femmes désireuses de briser le cycle infernal de la violence conjugale, peu de services spécialisés leur étaient offerts à cet égard. Faute de moyens humains et financiers, sinon de connaissances et de compétences spécialisées, les intervenantes pratiquant sur le terrain avaient tendance à référer vers des ressources externes d’aide à l’employabilité les femmes désireuses de retourner aux études, de changer d’emploi ou de s’insérer sur le marché du travail. Force est d’admettre que ces ressources n’étaient pas adaptées à la problématique de la VC ni à celle de la VCPS, ce qui n’est plus le cas depuis la mise en œuvre d’un programme d’intervention spécialisée à ces fins.
En 2016, un projet pilote élaboré et réalisé par Isabelle Privé ― conseillère en orientation ― au sein de deux maisons d’hébergement (PasserElle et Maison Flora Tristan), en étroite collaboration avec des professeur·e·s de l’UQAM (Lise Lachance et Louis Cournoyer), a permis à des femmes hébergées au sein de ces ressources de bénéficier de services de conseils d’orientation de façon individuelle et collective. Ces conseils d’orientation ont alors amené les femmes ayant participé au projet pilote à identifier, à organiser et à réaliser un projet d’insertion professionnelle pouvant passer par un retour aux études ou une recherche d’emploi. À la fin de ce projet pilote, l’ensemble des parties prenantes ont constaté que les participantes ont pu développer des stratégies adaptatives pour se réaliser tant comme femmes, comme mères cheffes de familles monoparentales que comme travailleuses.
Forte de ces premiers constats, l’Alliance MH2 a donc voulu prendre la balle au bond afin de développer un programme qui pourrait être déployé à l’ensemble de ses membres à travers la province, en débutant par Montréal. Soulignons que la notion de dévictimisation est au cœur de toutes ses actions. Il faut entendre par là un accompagnement de la victime dans le passage d’une sphère de vie privée oppressante vers une sphère publique synonyme de droits non seulement symboliques, mais également concrets. D’objet, la femme victime devient donc sujet, actrice de sa propre vie et consciente de tous les processus à l’œuvre dans sa situation. On comprend alors que l’autonomisation socioprofessionnelle devient une condition essentielle qui favorise la poursuite d’une vie plus libre et exempte de violence.
Le projet pilote a permis d’identifier des besoins à combler chez les maisons membres de l’Alliance MH2 :
- accéder à des services de développement de carrière et d’orientation au sein même des maisons de 2e étape;
- accroître l’employabilité et le sentiment d’efficacité personnelle des femmes par une plus grande estime et mobilisation de leurs ressources personnelles (intérêts, valeurs, besoins, habiletés, etc.), considérant les événements de VC traversés et le vécu de VCPS, dont le risque d’homicide conjugal;
- accompagner une mise en action stratégique et personnalisée de ces femmes au regard de l’élaboration et de la concrétisation d’un projet de vie cohérent avec leur situation personnelle, et leurs aspirations, et ce, par différentes étapes requises à court, moyen et long terme (études, recherche d’emploi, francisation, etc.)
- arrimer les actions de développement de carrière aux activités de soutien psychosocial fournies par les MH2 afin d’en bonifier les impacts positifs chez les femmes.
Encore sous le choc de la violence subie, les femmes hébergées en 2e étape peuvent avoir de la difficulté à créer un lien de confiance assez fort pour maintenir un processus jusqu’à sa finalité en dehors des murs de la ressource, lequel est nécessaire pour accroître leur sentiment de sécurité. En effet, il importe de souligner que les femmes hébergées en 2e étape ne sont pas portées à sortir des maisons pour des raisons évidentes de sécurité. À ce besoin de sécurité physique s’ajoutent toutes les répercussions psychologiques de la VC, telles que le syndrome de stress post-traumatique, les traumatismes craniocérébraux, l’anxiété, la dépression, la diminution du sentiment d’efficacité et d’estime personnelle, la perte des habiletés sociales nécessaires pour faire face au monde extérieur, etc. Le fait d’exercer un travail ou même de se projeter dans cette perspective peut donc aider les femmes à se recentrer sur leurs intérêts, à réaliser qu’elles possèdent toujours certaines habiletés, dont des habiletés socioprofessionnelles, les amener à se sentir plus libres et davantage productives, à développer et à entretenir des relations nourrissantes et, surtout, à améliorer leurs conditions de vie pour elles et pour leurs enfants, le cas échéant. Par conséquent, réussir à intégrer un service spécialisé en développement de carrière ou en orientation au sein du panier actuel de services offerts en MH2 permet d’offrir les conditions propices à l’atteinte de l’objectif fondamental d’autonomisation socioprofessionnelle. Voilà pourquoi l’Alliance a jugé nécessaire de développer et de pérenniser un programme d’autonomisation professionnelle adapté aux difficultés d’employabilité et de prise de décision de carrière de femmes victimes de violence conjugale. Mentionnons à cet effet le rapport de recherche sur les impacts des services en maison d’hébergement de 2e étape qui souligne le besoin des femmes hébergées d’avoir des outils concrets via les intervenantes pour les amener à poursuivre leur processus et se donner des repères à la fin de leur séjour (Tanguy et al., 2017). C’est dans un tel contexte que le programme Chevalière en mission prend toute son importance. C’est un programme d’autonomisation socioprofessionnelle qui peut aider à garantir une dévictimisation à moyen et à long terme.
Il importe également de souligner les coûts importants subis par les victimes. En effet, ils sont évalués à environ six milliards de dollars chaque année au pays, ce qui inclut notamment les jours de travail perdus, la rémunération perdue, la perte de productivité ou encore la formation perdue (Zhang et al, 2012). La VC et la VCPS affectent donc négativement la vie professionnelle des victimes. À cet effet, l’étude menée par l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH) confirme trois difficultés majeures liées tant aux obstacles pour mettre fin à une relation violente qu’au retour au travail pour les femmes victimes de VC :
- Une fois qu’elles ont quitté l’environnement violent, une perte d’estime de soi rend difficiles le sentiment de valeur personnelle et le développement de compétences pour agir. De plus, l’isolement empêche le développement d’un réseau relationnel essentiel lors de la recherche d’un emploi, et une relation violente peut conduire la victime à rejeter toute forme d’autorité, même dans un contexte professionnel.
- Les violences conjugales entraînent des conséquences sur le travail : perte de productivité, démission, remplacements, congés de maladie et absences prolongées, harcèlement par un (ex)- partenaire sur le lieu de travail, mise en danger et stress des collègues.
- L’effet du statut professionnel a un impact direct sur la violence et le maintien dans une spirale négative : les chômeur∙se∙s, les étudiant∙e∙s et les handicapé∙e∙s subissent davantage de violences conjugales, tandis que les moins exposé∙e∙s sont les retraité∙e∙s. (Projet Actif / ERASMUS+, 2021 : 45)
La violence économique, tant pendant la relation qu’après celle-ci, est prépondérante chez les femmes hébergées en MH2. À la lecture du rapport d’activités 2021-2022 de l’Alliance MH2 (2022), on retient que 83 % des femmes hébergées au sein de ses maisons membres rapportaient avoir vécu de la violence économique pendant la relation. Et même si une fois que les femmes étaient séparées, le pourcentage descendait à 36 %, celui-ci demeure très inquiétant. Selon Statistique Canada (2011), malgré l’ampleur de la violence économique qui assure une dépendance de la victime envers le conjoint violent et toutes les conséquences qui en découlent, seulement 30 % des maisons d’hébergement du pays offraient des services liés à l’emploi, mais aucune n’indiquait offrir des services en counseling de carrière spécialisés pour les femmes victimes de violence conjugale. C’est justement cette lacune, bien identifiée par Isabelle Privé (2016), qui l’a poussée à offrir en MH2 un service spécialisé en autonomisation socioprofessionnelle adapté à cette clientèle.
Comme mentionné précédemment, les MH2 s’inscrivent sur un continuum de services offerts aux femmes victimes de VC. On dit qu’une femme peut tenter de quitter le conjoint violent de sept à dix fois avant de réussir à rompre définitivement. Les enjeux économiques font partie des freins et des obstacles majeurs évoqués par les femmes qui tentent de mettre un terme à une relation empreinte de violence. En améliorant leur autonomisation socioprofessionnelle, on augmente donc leurs chances de réussir à briser le cycle de la VC.
Lorsqu’une femme obtient un logement en 2e étape, le temps a passé et elle a habituellement pris la décision de mettre un terme de façon définitive à la relation violente. Les séjours en MH2 sont plus longs, variant de quelques mois à deux ans selon les ressources, avec une moyenne de six à huit mois (Alliance MH2, 2022). Les femmes hébergées ont alors davantage la possibilité de se poser, de prendre du recul et de faire des choix pour améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leurs enfants, lorsqu’elles en ont. Leurs réflexions peuvent notamment porter sur le plan professionnel, et il importe pour les intervenantes travaillant en MH2 d’avoir des options à proposer aux femmes qui en font la demande. Évidemment, un premier choix a dû être fait pendant leur séjour en maison d’urgence puisqu’elles avaient besoin d’argent pour répondre à leurs besoins primaires. Cependant, il n’est pas rare, compte tenu de leur état physique et psychologique, mais aussi des obstacles à un retour rapide à l’emploi tels que les recours judiciaires, l’absence de place en garderie, etc., que les femmes hébergées en urgence aient fait une demande d’aide sociale. Il s’agit d’une aide de dernier recours essentielle, mais qui comporte des effets pervers. Effectivement, il semblerait que lorsque les femmes font une demande d’aide sociale après avoir été victimes de VC, cela diminuerait leurs chances d’investir le marché du travail dans le futur (Lindhorst et al., 2007, cités par Privé, 2016).
Puisque les femmes en MH2 bénéficient d’un séjour plus long avec des services psychosociaux intégrés au sein de la ressource, on peut espérer diminuer l’effet pervers de l’aide sociale sur leur trajectoire de vie en leur offrant un service en autonomisation professionnelle pendant leur séjour en MH2. De plus, le séjour en MH2 permet de respecter le processus des femmes victimes de violence conjugale, ce qui est capital pour assurer l’atteinte des objectifs. En effet, c’est un processus qui prend du temps, qui n’est pas linéaire et qui est très spécifique à chaque femme selon sa situation personnelle. Il importe de comprendre que le vécu de VC et de VCPS va influencer le parcours de retour à l’emploi de la femme qui en a été victime et que, pour réussir sa réinsertion socioprofessionnelle, il lui faut des services qui en tiendront compte (Projet Activ / ERASMUS+, 2021). Ce sont toutes des raisons qui permettent de croire que le choix d’offrir ce type de service pendant les séjours en MH2 peut être davantage couronné de succès. De plus, nous pouvons souligner que les MH2 utilisent l’intervention féministe lorsqu’elles interviennent auprès des femmes hébergées. À ce sujet, Khan (1988) rappelle que la combinaison de l’approche féministe à celle de l’approche sociocognitive de carrière des professionnel∙le∙s en développement et en counselig de carrière est gagnante. En effet, l’intervention féministe utilisée au sein des MH2 amène les intervenantes à miser sur les forces des femmes. Ainsi, les intervenantes reconnaissent le potentiel des femmes hébergées, leurs compétences, leur capacité à prendre les bonnes décisions pour elles-mêmes et leur capacité à s’en sortir. Dans cette optique, le programme Chevalière en mission permet aux femmes victimes de VC de reprendre du pouvoir sur leur vie en (ré)apprenant à reconnaître leurs forces, notamment en puisant dans leurs expériences de vie pour transférer les compétences développées à travers les années et en les transposant dans un contexte socioprofessionnel. Un des objectifs de l’intervention féministe est certainement de favoriser l’empowerment des femmes tout en respectant leur rythme. Cette approche vient donc, tel que mentionné, compléter l’approche sociocognitive de carrière des professionnel∙le∙s en développement et en counselig de carrière.
L’approche de counseling de carrière, proposée pour ce projet, s’inspire du Modèle d’action décisionnelle adaptative (Cournoyer et Lachance, 2019). Ce modèle est un cadre intégratif pour analyser les processus d’actions adaptatives liés aux carrières et à l’équilibre des rôles dans la vie (Cournoyer et al., 2016; Cournoyer et Lachance, 2018). Il intègre des éléments des principales perspectives théoriques reconnues dans le domaine du développement de carrière : 1) traits-facteurs (adéquation entre les caractéristiques personnelles et celles de son environnement), 2) développementaux (avancement à l’égard de stades de développement et d’expériences de transition), 3) sociocognitifs et décisionnels (prise en compte de facteurs, de conditions et de dispositions pouvant influencer les trajectoires scolaires et professionnelles), 4) constructivistes (conception de soi, des autres, du monde et portée symbolique de l’action humaine), 5) socioculturels et contextuels (prise en compte de dimensions sociales, culturelles, démographiques, économiques, etc., pouvant faciliter ou entraver le développement, comme les inégalités et les iniquités pour la personne) (Cournoyer, 2020; Cournoyer et Lachance, 2018).
La prémisse guidant l’intervention en counseling de carrière selon le modèle d’action décisionnelle adaptative est que la satisfaction des besoins adaptatifs des individus, comme celui d’autonomie socioprofessionnelle, dépend des « stratégies d’ajustement » plus ou moins adaptatives, à la fois intra, inter et extrapersonnelles, mises en œuvre au regard de « forces de contextes » plus ou moins facilitantes ou entravantes, pouvant également être intra, inter et extra personnelles. Ces actions et ces décisions réalisées sont façonnées par le parcours de vie de l’individu (temps et espaces sociohistoriques traversés, conjonctures de vie, vies interreliées, agentivité humaine), ainsi que par les projets personnels qu’élaborent et réalisent, ou non, les individus (Cournoyer et al., 2021). L’intervention du counseling de carrière basée sur le modèle d’action décisionnelle s’opère en trois phases (Cournoyer et al., 2021). La première phase vise à amener la personne à réaliser un retour du passé au présent afin de reconnaître les événements marquants de son parcours ayant pu participer au développement et à la mobilisation de ressources particulièrement signifiantes pour elle (phase reconnaissance). Pour la deuxième phase, elle est amenée à se projeter du présent au futur au travers de l’exploration, de l’identification et de l’analyse de projets personnels plus signifiants, pour lesquels ses valeurs et ses besoins plus prépondérants sont révélés, de même que les forces de contextes pouvant contribuer à faciliter ou entraver le développement de son autonomie socioprofessionnelle (phase de quête). Enfin, la troisième phase propose l’élaboration d’un plan d’action de développement de son autonomie professionnelle s’appuyant sur les ressources développées et mobilisées de son parcours de vie, en fonction de projets personnels ciblés, en tenant compte de stratégies d’ajustement adaptatives à mettre en place selon les forces de contextes propres à chacune des participantes.
Ce modèle d’intervention s’imbrique bien avec les préceptes de l’intervention féministe. Il permet aux femmes de reconstruire leur estime personnelle et de les soutenir pour qu’elles puissent briser leur isolement. Soulignons que plus largement, l’intervention féministe incluse au sein du modèle proposé vise le changement social, l’égalité et la suppression de l’oppression sous toutes ses formes (Alliance et al., 2017 : 13). En terminant, le programme d’intervention prend en compte le sentiment de sécurité comme élément incontournable pour que les femmes victimes de VC se donnent la chance d’en faire l’intégration et s’engagent dans une démarche d’autonomisation socioprofessionnelle. Entre autres, le fait d’offrir le programme à l’intérieur de la MH2, avec une conseillère en orientation référée par la ressource elle-même, contribue à faciliter le lien de confiance ainsi que la participation des femmes.
Un projet pilote qui a évolué
Tel que mentionné, tout a commencé par un projet pilote de services en orientation socioprofessionnelle offert aux femmes hébergées à PasserElle et à la Maison Flora Tristan, deux MH2 de la région montréalaise. Ce service était accessible puisqu’il était gratuit, sur place et qu’il incluait le gardiennage pour les femmes avec enfants. L’Alliance MH2 a fait bénéficier ses maisons membres d’un projet plus élargi en siégeant à un comité d’encadrement avec le SAC-UQAM et des professeur∙e∙s d’université1Les partenaires ayant été impliqués dans le Comité d’encadrement de cette phase du projet (par ordre alphabétique) sont : Louis COURNOYER, professeur à la section Counseling de carrière du Département d’éducation et pédagogie de l’Université du Québec à Montréal ; Chloé DERAICHE, directrice générale de la Maison Flora Tristan, membre de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale ; Mélisande DORION-LAURENDEAU, agente de liaison et soutien à l’intervention à l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale ; feu Gaëlle FEDIDA, coordonnatrice des dossiers politiques à l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (de 2018 à 2019) ; Lise LACHANCE, professeure à la section Counseling de carrière du Département d’éducation et pédagogie de l’UQAM ; Ève-Marie LAMPRON, agente de développement au Service aux collectivités, UQAM ; Chantal LEPIRE, conseillère d’orientation et chargée de cours, UQAM (de 2020 à 2022) ; Maud PONTEL, coordonnatrice à l’administration et vie associative à l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (de 2019 à 2022) ; Isabelle PRIVÉ, conseillère d’orientation et coordonnatrice de projet, UQAM (de 2018 à 2020). Il s’agit d’une recherche-action offerte dans un premier temps aux MH2 de Montréal, déployée par la suite au reste de la province. En fin de compte, la migration vers les différentes plateformes technologiques de visioconférence dû à la pandémie a rendu cela possible. En effet, la conseillère en orientation a ainsi pu offrir des services individuels et collectifs à des femmes provenant des maisons membres des différentes régions du Québec puisque la distance n’était plus un obstacle. Au total, le projet Chevalière en mission a touché 25 femmes de six MH2 provenant de quatre régions du Québec au cours des années 2019-2021.
Le programme Chevalière en mission a également été pensé et développé de façon que les intervenantes en MH2 puissent elles-mêmes soutenir les femmes hébergées dans leurs réflexions socioprofessionnelles grâce aux différentes activités qui le composent. Ainsi, les activités du programme peuvent être réalisées à la pièce lorsque le programme n’est pas fait dans son entièreté. Cet outil, mis à la disposition des maisons membres de l’Alliance MH2, fait dorénavant partie du panier de services offerts aux femmes qui séjournent au sein d’une des maisons membres.
Les retombées du projet
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’autonomie socioprofessionnelle est d’une importance capitale pour permettre aux femmes de quitter la relation violente. La mise en place d’un programme qui vise à soutenir et à encourager les démarches d’autonomisation socioprofessionnelle de femmes monoparentales cheffes de famille ayant vécu de la VC est d’autant plus importante. Ce projet, une première au sein des maisons d’hébergement, est donc novateur et en cohérence avec les objectifs plus généraux de l’intervention féministe qui visent l’autonomisation globale des personnes hébergées. D’une part, il offre aux femmes la possibilité de reprendre, économiquement et socialement, du pouvoir sur leur vie. D’autre part, il favorise, en quelque sorte, le bris du cycle de la pauvreté engendrée par la violence, de même que du cycle de la violence lui-même, en leur permettant d’envisager l’avenir sans cette pernicieuse insécurité économique qui, parfois, est un facteur de retour avec le conjoint violent. Par ailleurs, ce programme permet aux femmes de découvrir leur potentiel et de faire valoir leurs compétences. Rappelons que dans une dynamique de VC, les compétences des femmes et leur potentiel sont annihilés et les stratégies de survie font en sorte qu’elles ne peuvent se concentrer sur les aspects socioéconomiques de leur vie ni sur ceux de leurs enfants, le cas échéant. L’évaluation préliminaire a été plus que positive pour les femmes ayant participé au programme. Elles ont notamment cité avoir développé une meilleure connaissance d’elles-mêmes (« Le programme m’a permis de me rendre compte que j’avais fait beaucoup de choses et que maintenant, je voulais faire vraiment ce que je voulais par rapport à mes intérêts, mes valeurs et mes ressources. ») ainsi qu’un plus grand sentiment d’efficacité personnelle tant dans la sphère professionnelle que dans les autres sphères de leur vie (« Ça m’a beaucoup aidée, je me sens bien, j’ai vraiment confiance en moi dans tout, pas seulement dans ce que j’aimerais apprendre, mais c’est dans tout, même dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, ma vie comme familiale, je me sens vraiment comme bien, je peux prendre une décision sans parler à une autre personne vu que c’est ma vie. »). Elles ont également souligné le côté bénéfique que l’expérience de contact et d’apprentissage avec d’autres femmes vivant la même situation, les mêmes problématiques, leur a apporté (« Les femmes ont partagé beaucoup de leur vécu et de leurs craintes, leurs appréhensions, j’ai vraiment aimé ça de voir justement… bien de partager le vécu avec d’autres personnes. On se rend compte qu’on n’est pas seule et c’est vraiment important je trouve les rencontres de groupe. »). Elles ont, par exemple, observé un accroissement de leur estime personnelle, un élargissement de leur bassin de ressources, le développement de leurs stratégies pour faire face à différents obstacles ainsi qu’une meilleure conscientisation de leurs forces avec l’élaboration d’un projet professionnel incluant un plan d’action échelonné à court, moyen et long terme (« Ça m’a encouragée à être déterminée et de croire en moi. Même que je suis capable peu importe les obstacles, parce qu’il y aura toujours des obstacles. Il n’y a rien qu’on dit… on veut faire ça et puis ça arrive comme ça d’un coup. On doit se battre comme l’image de la femme avec les épées … pour arriver à l’objectif, on doit passer par ces obstacles-là, à ces problèmes. Mais dans notre tête, il faut être déterminée, tu dois te dire… moi, je suis déterminée à arriver, peu importe les obstacles, je vais me battre et je vais y arriver. »). L’accompagnement, tout au long du programme, en individuel comme en groupe, a pu amener les femmes à identifier leurs besoins d’autonomie socioprofessionnelle, à prendre conscience des forces portées en elles et autour d’elles pouvant faciliter ou entraver leur bien-être, de même que les stratégies plus ou moins adaptatives mises en œuvre à ce jour et celles optimales à réaliser afin d’accroître leur engagement (« Bien en fait, j’ai arrêté de rêver et j’ai commencé à vivre mes rêves au lieu de les rêver simplement. Oui, je suis même tout émue. Je suis toute en émotion en le disant, mais oui, ça m’a vraiment donné des ailes ».). La démarche a également permis aux personnes intervenantes de reconnaître les attitudes et les comportements nécessaires pour accompagner efficacement des femmes victimes de VC en contexte de développement d’autonomie socioprofessionnelle (par exemple, écouter sans juger; établir et maintenir une alliance de travail; témoigner de patience et de persévérance; guider, accompagner et mobiliser l’orientation; maintenir la motivation et la centration sur soi; partager son vécu commun; organiser les séances et réaliser des suivis). Les femmes qui ont pu bénéficier des activités du programme ont ainsi eu l’occasion, dans un cadre sécuritaire et dans le respect de leur rythme, de (re)prendre conscience de leur valeur, de leurs compétences et de leur potentiel. Pour les femmes qui ont pu compléter le programme dans son entièreté, l’avenir s’envisage à présent par une reprise des études, de formations ou de recherche d’emploi.
Soulignons tout de même que la recherche scientifique formelle en cours permettra de bonifier le programme, d’effectuer des représentations auprès des ministères afin de le pérenniser et de s’assurer qu’il soit intégré de manière soutenue au panier de services des MH2. En outre, afin de favoriser la pérennisation du programme, les professeur∙e∙s impliqué∙e∙s pourront l’intégrer dans les cursus universitaires et former des conseillers∙ère∙s d’orientation, en partenariat avec les maisons membres de l’Alliance MH2 présentes dans les différentes régions du Québec. C’est ainsi que le programme Chevalière en mission et des conférences sur la VCPS ont pu être présentées hors de nos réseaux habituels lors de différents colloques et conférences (Université d’été de Trajetvi, webinaire offert aux membres de l’association québécoise des professionnel∙le∙s de développement de carrière, colloque de l’Ordre des conseillers et conseillères en orientation).
Le programme Chevalière en mission (conception et description du programme ainsi que le cahier de la participante) est déjà disponible pour les maisons de 2e étape membres de l’Alliance MH2 et pour les personnes professionnelles en développement de carrière et en orientation professionnelle qui interviennent auprès de femmes victimes de VC. Rappelons à cet effet qu’il est donc possible pour des personnes intervenantes, qui ne sont pas conseillères ou conseillers d’orientation, d’intervenir à partir des activités décrites de ce programme, mais dans les limites de leur champ de compétences. Ces personnes sont également invitées, en cas de besoin, à référer les personnes clientes à des conseillères, des conseillers d’orientation, ou à d’autres personnes professionnelles concernées (Cournoyer et al., 2021 : V).
Le programme peut ainsi se déployer à travers la province, et même au-delà, pour rejoindre un maximum de femmes victimes de VC.
Une retombée inattendue, et à souligner, est certainement le fait que Chantal Lepire, conseillère en orientation, a pu identifier, alors qu’elle accompagnait les femmes hébergées en MH2 dans le cadre du programme, des barrières systémiques et étatiques en lien avec le retour aux études ou à l’emploi pour les femmes monoparentales et, incidemment, pour les femmes victimes de VC qui ont des enfants et qui ont perdu leur réseau social, familial et professionnel dû à la VC. Elle a donc mis en lumière cette réalité qui n’était pas connue par les membres du Comité d’encadrement du programme Chevalière en mission, incluant les membres du milieu de pratique. Cela aura permis de mettre en chantier une nouvelle recherche « Développement de carrière de femmes monoparentales et victimes de violence conjugale : défis et pistes de solutions du point de vue des femmes et des personnes professionnelles intervenant auprès d’elles ». Cette nouvelle recherche permettra de mieux documenter le phénomène, afin d’ultimement contribuer à lever les nombreuses barrières (notamment structurelles) vécues par les femmes, en s’adressant aux décideur∙euse∙s et aux groupes d’influence concernés (Services Québec, ministères, etc.).
L’apport de la dimension partenariale du projet
Ainsi, le projet Chevalière en mission est le résultat d’un partenariat entre le milieu de la pratique en VC et celui de la recherche en counseling de carrière. Le rôle du Service aux collectivités et de l’équipe-UQAM a été instrumental et fondamental dans la structuration et le développement du projet. Ce partenariat aura permis de coconstruire ce magnifique programme qu’est Chevalière en mission. L’encadrement fantastique et bienveillant des professeur∙e∙s ainsi que le soutien gigantesque de l’agente de développement du Service aux collectivités de l’UQAM dans l’ensemble des tâches et ressources humaines universitaires rattachées au projet s’est fait de manière efficace et structurée, de telle sorte que nous avons pu nous adapter et mieux comprendre l’ensemble de l’écosystème universitaire, administratif, ainsi que le milieu de l’orientation et du développement de carrière. Leur collaboration à la conception, l’implantation et l’évaluation du programme d’intervention ainsi qu’à la production de guides d’accompagnement pour les intervenant∙e∙s et les femmes hébergées nous a permis de bénéficier d’un apport théorique considérable en lien avec le champ du développement de carrière et de l’orientation, ce qui aurait été impossible autrement. Cet apport d’expertise est une garantie solide de la viabilité du programme en regard des exigences et des attentes du milieu des organismes et personnes-ressources œuvrant en développement de carrière et en orientation. Sur le plan des activités de transfert et de diffusion auprès des conseiller∙ère∙s d’orientation et de professionnel∙le∙s du développement de carrière œuvrant en milieu communautaire ou autres secteurs, l’équipe-UQAM a fait preuve de leadership et a travaillé de manière collaborative. En effet, elle s’est assurée de la capacité du programme à être connu et reconnu comme un outil novateur et pertinent de développement, visant particulièrement des femmes ayant vécu des situations de VC et VCPS.
Les expertises complémentaires de ce partenariat a permis de joindre les besoins identifiés sur le terrain au sujet d’assises théoriques et d’une expertise en counseling de carrière que nous ne retrouvions pas au sein des maisons. Grâce au programme, des femmes ont pu bénéficier de services spécialisés donnés par des CO et le cartable développé pour le programme permet d’outiller les intervenantes en MH2 pour accompagner les femmes dans leur besoin d’autonomisation socioprofessionnelle. Le cartable d’activités a effectivement été conçu pour les intervenantes par le milieu universitaire, mais révisé aussi en partenariat avec le terrain pour s’assurer que chaque activité soit accessible et bien comprise. Le choix du visuel et des mots utilisés a, tout au long du processus, été réfléchi en partenariat, s’assurant qu’ils conviennent aux deux parties. Pour l’Alliance MH2, le projet est une histoire partenariale de grand succès!
Ce projet a également permis de développer des connaissances et des compétences uniques en matière de compréhension des enjeux de carrière propres aux femmes victimes de violence conjugale ainsi que de mieux circonscrire les balises propres à une intervention ciblée auprès d’elles en matière de counseling de carrière. De telles connaissances et compétences pourront être incluses au sein de cours liés à la conception et à l’évaluation de l’impact des interventions, de même qu’à ceux d’intervention directe auprès d’individus et de groupes. Cela permettra aussi aux personnes étudiantes et aux personnes diplômées d’exercer un rôle-conseil auprès de leurs collègues dans différents milieux d’emploi en développement de carrière. Des articles professionnels ainsi que des communications dans le cadre de colloques pourront être produits de manière à rejoindre, à sensibiliser et à former la communauté professionnelle des personnes conseillères d’orientation et leur ordre professionnel. En matière de recherche, il y a très peu de connaissances à l’heure actuelle sur les pratiques d’intervention en matière de counseling spécifique à la carrière auprès de femmes victimes de violence conjugale. Les résultats liés au développement et à l’expérimentation du programme Chevalière en mission pourront permettre de mieux problématiser et de mieux conceptualiser différentes variables pouvant intervenir lorsqu’on lie l’expérience de violence conjugale avec le développement de carrière, en plus d’ouvrir de nouvelles perspectives d’intervention. À ce propos, une autre chercheure, Chantal Lepire, de l’Université du Québec à Rimouski, a entrepris un projet de recherche en collaboration avec les collègues Lise Lachance et Louis Cournoyer de l’Université du Québec à Montréal dans le but de mieux comprendre les défis et les solutions en matière de développement de carrière pour les femmes monoparentales et victimes de violence conjugale, du point de vue de ces dernières, mais aussi des personnes intervenantes. De telles initiatives permettront d’inscrire au Québec une expertise en la matière.
Notes de bas de page
- 1Les partenaires ayant été impliqués dans le Comité d’encadrement de cette phase du projet (par ordre alphabétique) sont : Louis COURNOYER, professeur à la section Counseling de carrière du Département d’éducation et pédagogie de l’Université du Québec à Montréal ; Chloé DERAICHE, directrice générale de la Maison Flora Tristan, membre de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale ; Mélisande DORION-LAURENDEAU, agente de liaison et soutien à l’intervention à l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale ; feu Gaëlle FEDIDA, coordonnatrice des dossiers politiques à l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (de 2018 à 2019) ; Lise LACHANCE, professeure à la section Counseling de carrière du Département d’éducation et pédagogie de l’UQAM ; Ève-Marie LAMPRON, agente de développement au Service aux collectivités, UQAM ; Chantal LEPIRE, conseillère d’orientation et chargée de cours, UQAM (de 2020 à 2022) ; Maud PONTEL, coordonnatrice à l’administration et vie associative à l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (de 2019 à 2022) ; Isabelle PRIVÉ, conseillère d’orientation et coordonnatrice de projet, UQAM (de 2018 à 2020)
Bibliographie
Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. (2022). Rapport annuel 2021-2022 : Déploiement et consolidation.https://www.alliancemh2.org/site/assets/files/1213/rapport_annuel_amh2_2021-2022.pdf
Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, Deraiche, Chloé, Fedida, Gaëlle et Gough, Nancy. (2017). Cadre de référence. L’association provinciale et ses maisons membres.
Cournoyer, Louis (2020). 5 approches pour accompagner son développement de carrière. Trouve ton X, AXTRA. https://trouvetonx.ca/orientation-formation/5-approches-developpement-de-carriere/
Cournoyer, Louis et Lachance, Lise (2018). L’Ado en mode décision. 7 profils pour mieux comprendre et aider son choix de carrière. Septembre Éditeurs.
Cournoyer, Louis et Lachance, Lise (2019). Decision-Action Model: Overview and Application to Career Development. Dans Nancy Arthur, Roberta Nault et Mary McMahon (dir.), Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice (p. 93-101). CERIC.
Cournoyer, Louis, Lachance, Lise et Samson, André (2016). L’action décisionnelle de carrière : processus en deux dimensions, quatre tensions. Dans Jonas Masdonati, Marcelline Bangali et Louis Cournoyer (dir.), Éducation et vie au travail : Arrêt sur image! Perspectives contemporaines sur les parcours d’orientation des jeunes (p. 119-148). Presses de l’Université Laval.
Cournoyer, Louis, Privé, Isabelle, Lachance, Lise et Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. (2021). Chevalière en mission : Programme en orientation de carrière visant l’autonomisation socioprofessionnelle de femmes victimes de violence conjugale. Service aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal/Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. https://sac.uqam.ca/upload/files/Cournoyer_et_al_Programme_VF1.pdf
Cousineau, Marie-Marthe, Fedida, Gaëlle, Tanguy, Adélaïde et Desauguste, Salène (2016). Sondage sur les besoins en hébergement de 2e étape pour femmes victimes de violences conjugales, 2e édition. Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale et Trajetvi. https://www.alliancemh2.org/site/assets/files/1229/3_sondage_sur_les_besoins_en_mh2.pdf
Lindhorst, Taryn, Oxford, Monica et Gillmore, Mary Rogers (2007). Longitudinal effects of domestic violence on employment and welfare outcomes. Journal of Interpersonal Violence, 22(7), 812-828. https://doi.org/10.1177/0886260507301477
Privé, Isabelle (2016). Les besoins en orientation de carrière de femmes victimes de violence conjugale au Québec [Projet de recherche déposé dans le cours CAR8920, document non publié]. Université du Québec à Montréal.
Projet Activ / ERASMUS+. (2021). Pour un retour à l’emploi réussi des femmes confrontées aux violences conjugales : guide et éléments-clés. https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/mep_activ_io1_fr-final.pdf
SOS violence conjugale. (2022). 6 formes de violence économique. https://sosviolenceconjugale.ca/fr/outils/sos-infos/6-formes-de-violence-economique
Tanguy, Adélaïde, Cousineau, Marie-Marthe et Fedida, Gaëlle (2017). Impact des services en maison d’hébergement de deuxième étape. Trajetvi et Alliance des maisons d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. https://alliancemh2.org/site/assets/files/1228/2_impact_des_services_en_mh2.pdf
Zhang, Ting, Hoddenbagh, Josh, McDonald, Susan et Scrim, Katie (2012). Une estimation de l’incidence économique de la violence conjugale au Canada en 2009. Ministère de la Justice Canada. https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/rr12_7/rr12_7.pdf
Deraiche, Chloé, Dorion-Laurendeau, Mélisande, Cournoyer, Louis, Lachance, Lis, 2023, « Chevalière en mission : programme en orientation de carrière visant l’autonomisation socioprofessionnelle de femmes victimes de violence conjugale », dans Ève-Marie Lampron, Ama Maria Anney, Mylène Bigaouette, Sophie Gilbert, Julie Raby et Marina Seuve (dir.), Le Protocole UQAM/Relais-femmes : 40 ans de retombées au service des savoirs et de l’action féministes, Cahier de l’IREF no10, en ligne sur PréfiX, https://revues.uqam.ca/prefix/cahiers-iref/chevaliere-en-mission-programme-en-orientation-de-carriere-visant-lautonomisation-socioprofessionnelle-de-femmes-victimes-de-violence-conjugale/
Cahier IREF
Ce travail est sous une licence CC BY-NC-ND 4.0.
